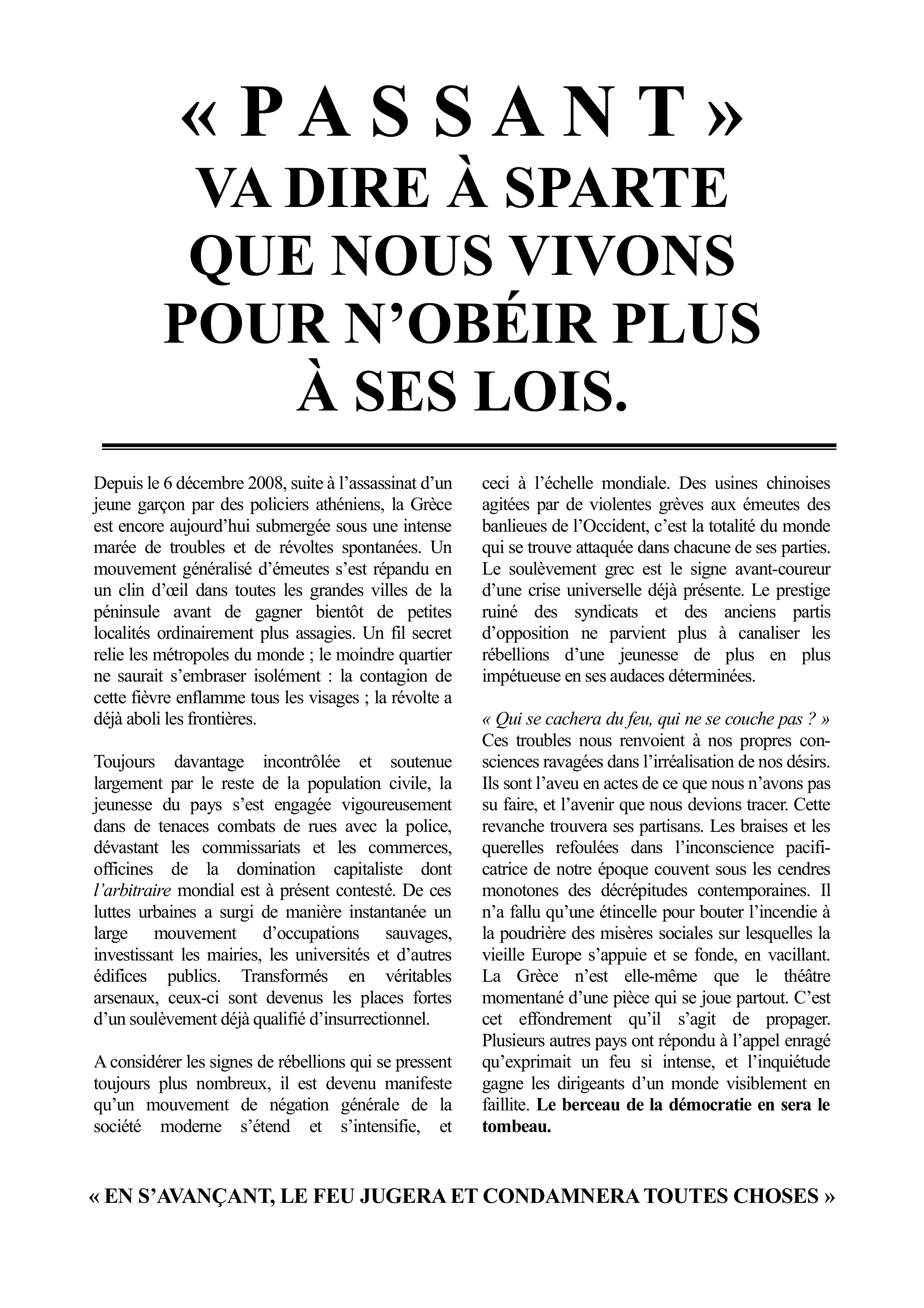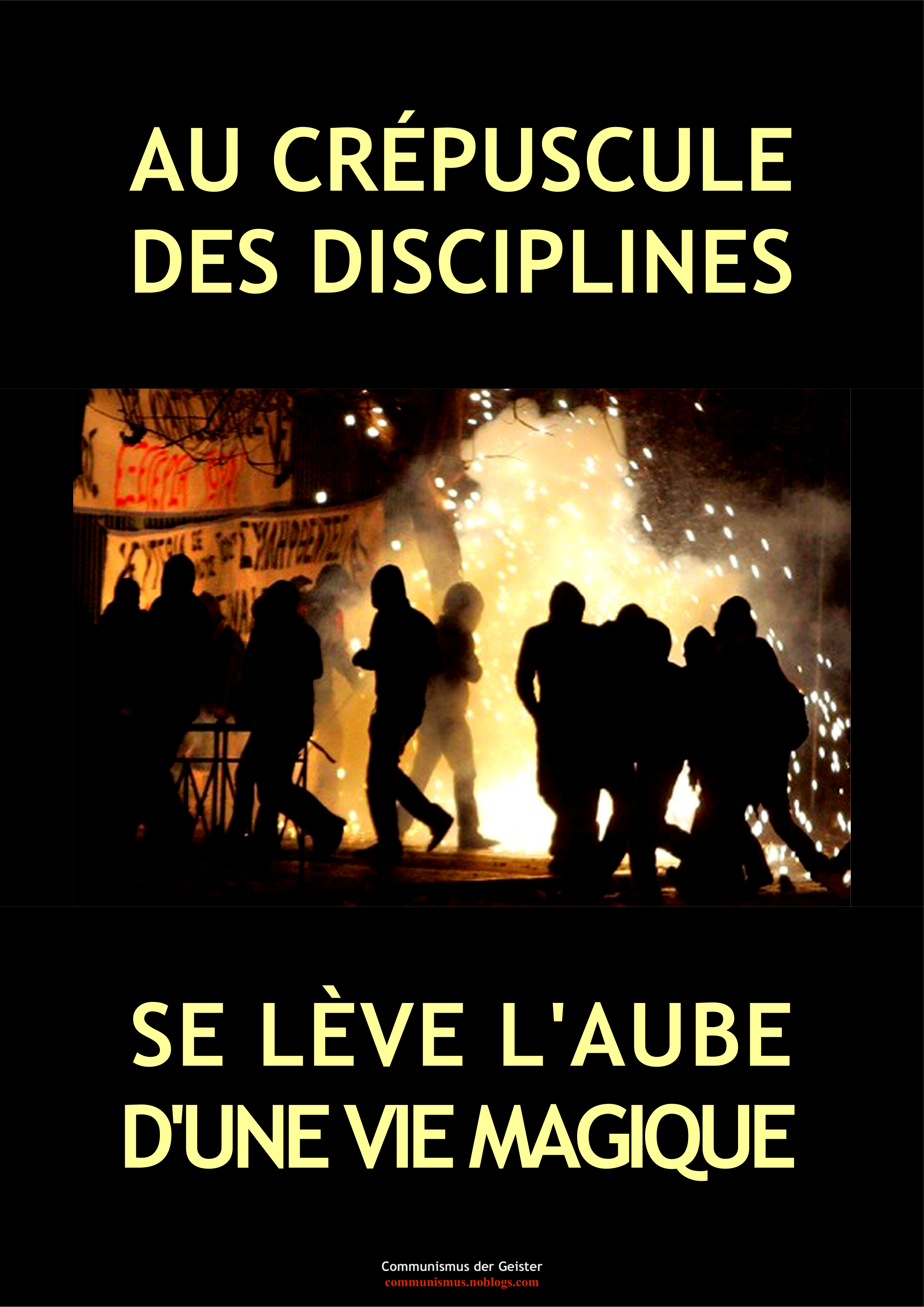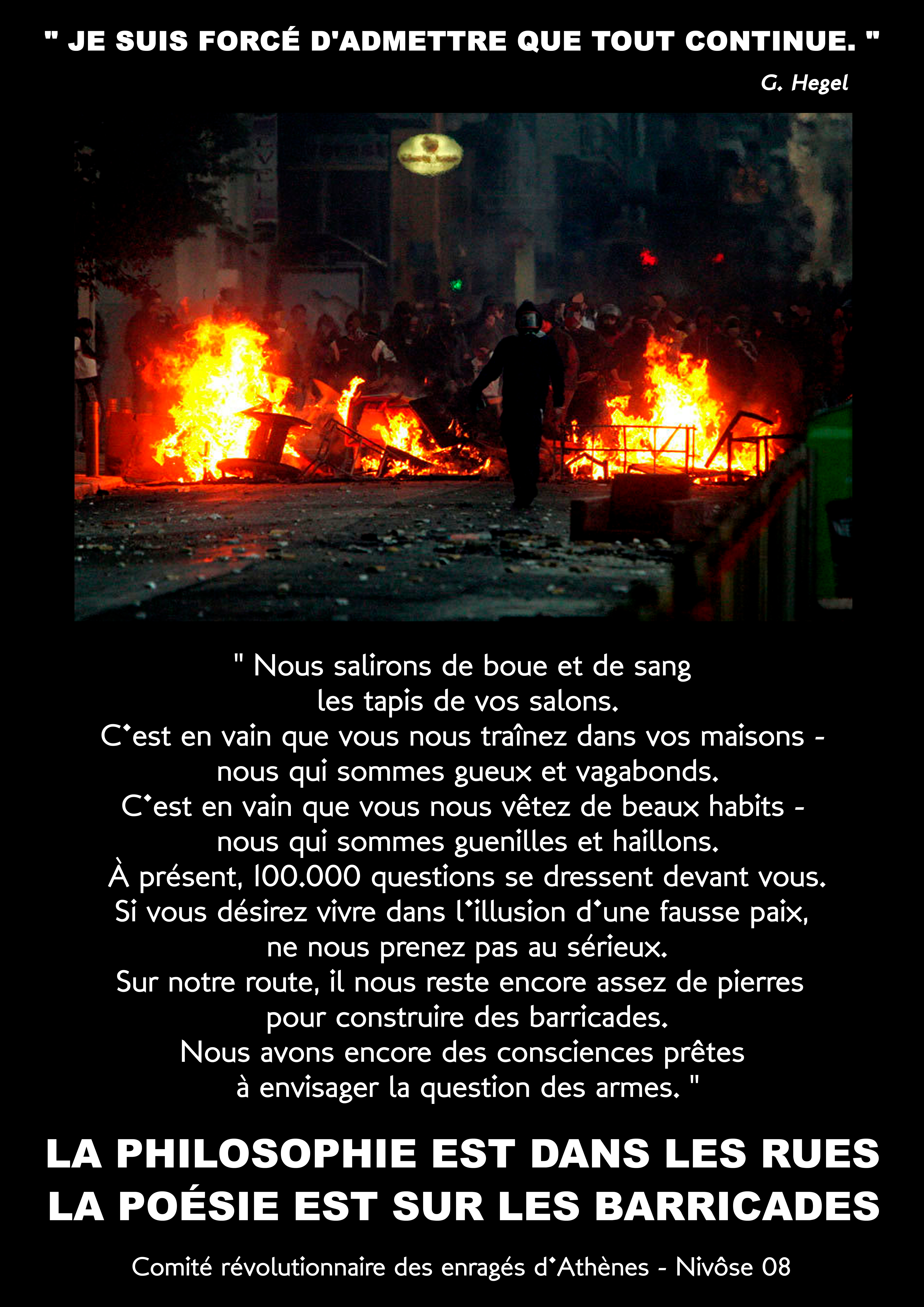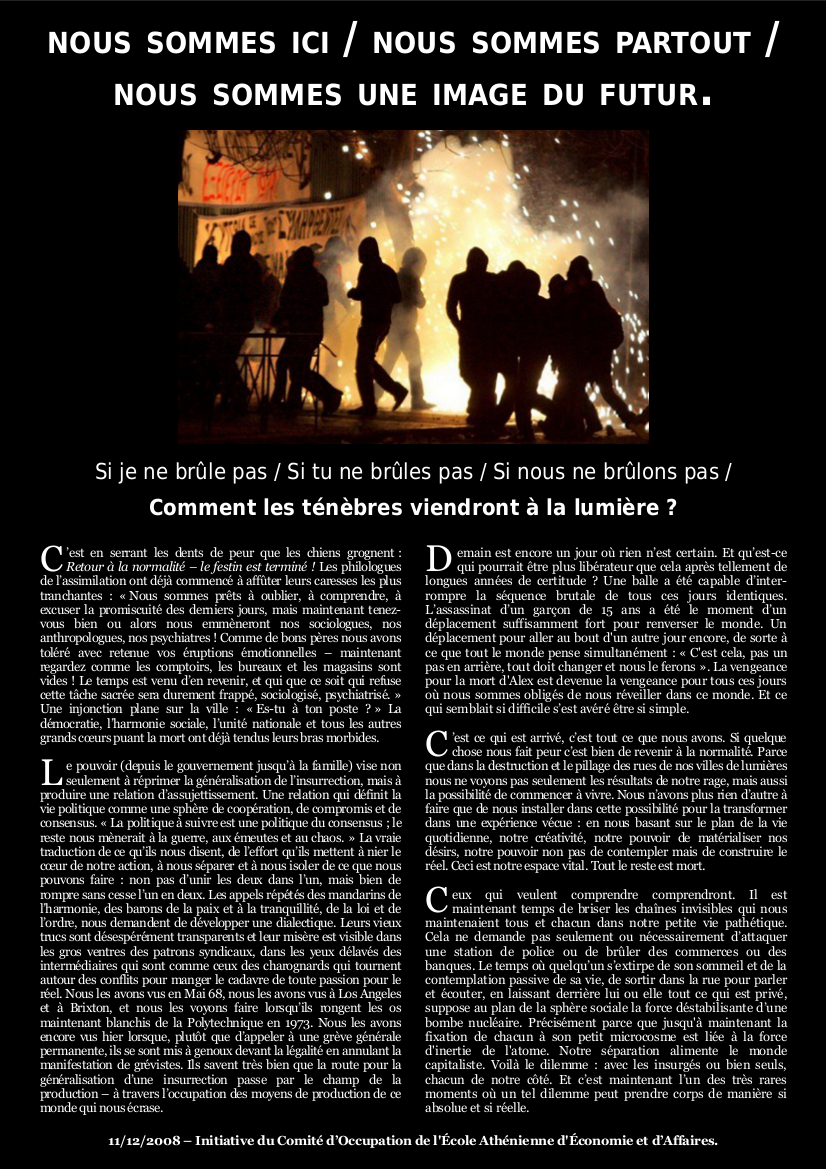La grève infinie

C’est une chose entendue. Le Parti de l’Ordre espère, à toute force, nous faire rentrer chez nous. Syndicats et gouvernement auront réussi à s’accorder. Là-dessus, au moins. Ils tablent sans doute sur l’attirance malheureuse qu’aurait pour nous l’insidieux sentiment de vide dans lequel nous avons si parfaitement désappris de vivre, et de lutter. En cela, ils se trompent. Nous ne rentrerons pas chez nous, nous qui ne nous sentons chez nous nulle part. S’il est bien un seul espace que nous avons aperçu comme habitable, c’est au sein de l’événement grâce auquel nous vivons, dans les intensités qui s’y dessinent. En fonction, surtout, des moyens que nous saurons nous donner.
C’est une chose entendue. Un processus insurrectionnel se renforce à mesure que les évidences qui, à ses yeux, en composent la réalité, deviennent imperceptiblement, aux yeux de tous, des vérités criantes. Le capitalisme étant un mensonge universel, la forme de sa négation, à l’inverse, sera celle d’une pluralité de mondes, solidairement mêlés aux vérités qui s’y rattachent.
Les mots par lesquels une situation se rend lisible à elle-même en déterminent directement les formes, et l’esprit. Les objectivations forcées n’en peuvent saisir, au mieux, que les contours indécis. La diversité des analyses, qu’elles proviennent du lexique sociologique ou du radicalisme militant, propagent de concert une identique confusion : celle de l’apologie poussive ou du pessimisme intéressé. À toutes, il leur manque ce minimum de sens tactique par lequel une parole trouve une lisibilité réelle, un Commun véritable, seul à même de dégager les possibles ouverts par la situation. Et d’écarter de soi comme autant de mauvais fantômes les découragements programmés. Le tranchant de cette voix, il est dans le choix des mots comme dans la positivité de leur orientation.
Pour élever l’intelligibilité stratégique des événements en cours, un premier geste s’avère nécessaire. Celui de se situer, de s’orienter. Parler de quelque part, non pas d’un simple point de vue, mais d’un parti.
1.
D’entrée de jeu, et c’est l’un de ses mérites, le mouvement a pris les choses par la racine. Blocages économiques généralisés, organisation délibérée d’une paralysie totale, refus des compromis et des négociations. Langages directs, bruts. Par là, il a rendu simplement effectif des mots d’ordre habituellement condamnés à l’attente angoissée, ou au simulacre. La grève s’est matérialisée dans des corps, des déterminations. Et c’est par là, aussi, qu’elle a pu apparaître comme véritablement menaçante. En quoi le mouvement, du point de vue des pratiques mises en place, se situe au-delà d’un simple mouvement social. En quoi il participe déjà d’un processus insurrectionnel. Voilà notre point de départ.
2.
Dressons ce constat : il ne reste rien, maintenant, de l’ancien mouvement révolutionnaire. Et tandis que sa relève semble s’enfoncer toujours un peu plus dans les sombres méandres d’un citoyennisme satisfait, nous pouvons avoir, par moment, la sensation d’un vide. Ce vide, il nous faudrait l’habiter. Et en faire une chance.
3.
Une superstition singulière affecte, en France, une grande majorité de corps par ailleurs si rigidement laïques : la croyance, aussi ténue qu’apparemment inébranlable, en la réalité du « mouvement social ». Son malheur réside en ceci : c’est une croyance en laquelle personne n’a plus foi. Elle ne fait que s’user, de « victoires » en « défaites », de reprises sporadiques en déprises finales, pour achever de s’élimer jusqu’à la trame. L’objet de cette croyance n’est, quant à lui, que l’héritier d’un naufrage : celui du mouvement ouvrier classique. Celui-ci n’a pas été, comme le soulignait Mario Tronti, vaincu par le Capital, mais par la Démocratie. Non pas sous la forme d’un dangereux objet extérieur, mais en ce qu’elle lui faisait front intérieurement. Ce lot d’illusions pèse sur lui d’un poids d’autant plus lourd qu’il n’est pas reconnu, par nous qui combattons.
4.
Un mouvement se définit négativement en fonction de ses limites. Son terrain d’action est aussi bien circonscrit par ce au-delà de quoi il ne veut pas aller. Sa finitude programmée le condamne à n’être que la conjuration hystérique d’une fin attendue. Sa vie elle-même n’est guidée que par la seule idée d’une fuite en avant toujours plus éperdue pour en retarder le dénouement, qui en était le moteur. C’est que sa fin est effrayante en ceci qu’elle n’est rien de moins que sa mort. Une temporalité séparée du cours de l’Histoire. Aussi n’a-t-elle pas vocation à durer. Elle est toujours à reprendre, laborieusement, depuis le début, à partir du même néant. Partant de là, nous ne pourrions que recommencer toujours, et n’apprendre jamais. Puisqu’il n’en reste rien. Fermer la parenthèse.
5.
Mais l’action véritable n’est pas suspendue à la tristesse de ce canevas, il n’y a pas de « retour à la normale ». Ce qu’il y a, en revanche, c’est la persistance d’un processus révolutionnaire, avec ses phases d’accélérations et ses décélérations souterraines. Aux yeux d’un pareil processus, il n’existe qu’un seul temps. Où rien ne s’oublie de ce qui n’est pas advenu. Ce qu’il y a, aussi bien, ce sont deux camps : d’un côté, ceux qui entendent appliquer une grève totale, une entrave irrémédiable à la circulation des flux et, de l’autre, les jaunes et les flics. L’entièreté de l’espace social est soumis à cette cruelle partition.
6.
C’est dans la mesure où une grève reconnaît participer d’un tel processus qu’elle demeure l’un de ces rares endroits où persiste une transmission d’expériences. Elle ne veut rien commémorer des luttes passées, mais bien les remémorer : c’est-à-dire les remettre en mémoire. Et cela, non seulement pour elle-même, mais pour l’insouciance d’un monde qui s’occupe à en organiser l’oubli.
7.
Il faut prendre garde à ce que le terrain sur lequel une situation se dit ne soit pas lui-même miné. C’est le cas du nôtre. Premier geste : déserter le terrain balisé par lequel une chose, un événement, s’envisage en tant que chose. Une chose n’est jamais pour elle-même. Car rien n’existe en dehors de l’intelligence qu’on en a. Il se pourrait que, à force d’en user, le vocable même de « mouvement social » ne cherche à désigner, en lui, qu’une impuissance. Opération sémantique d’une certaine sociologie. Qui, tant qu’on l’accepte, paralyse toute élaboration stratégique comme toute intelligence collective. C’est que la sociologie a été elle-même entièrement socialisée. Elle affecte tous les discours d’une même obsession du calcul statistique. Ne permet qu’une laborieuse objectivation du réel en catégories déprimantes. Mais ce qui façonne nos mondes lui demeure irrémédiablement hors d’atteinte. Nos amitiés ne sont, pour elle, que des valeurs aberrantes. L’inconnu invérifiable de leurs équations. L’infini d’une grève.
8.
Saint-Nazaire. Des défilés syndicaux débouchant systématiquement à des affrontements de plusieurs heures. Des caillassages héroïques et des barricades érigées en toute hâte. « Sarkozy, on t’encule » à mille voix entonnées. Un tribunal conjointement lapidé par des groupes d’émeutiers. Un ami disait alors : « Il est beau de voir une ville se soulever contre sa police ».
9.
Le sens de la lutte véritable n’est pas entre les classes, entre le Capital et le Travail, mais entre des partisans regroupés en fonction de leur culte pathologique du travail ou du dégoût pur et simple que celui-ci leur inspire. Désormais, il y a ceux qui veulent encore travailler, et ceux qui ne le veulent plus.
10.
Une troublante omertà règne à l’intérieur du mouvement. Elle consiste en une dénégation de ce que les événements en cours ne laissent pas de montrer : l’expression d’une souffrance, d’un douloureux refus du travail. On comprendra que ce n’est pas seulement une protestation localisée contre un allongement du temps de travail qui est ici en jeu, mais une pleine condamnation de comment, partout, le travail est vécu. À savoir : comme une calamité. Elle jette sur lui un discrédit sans équivoque. C’est l’ombre de la mort que l’on voit se profiler. Il est ce « vol des énergies » qui ensorcellent ceux qui en sont les dupes. Nous assistons à l’agonie du monde classique du Travail entraînant avec elle la figure qui s’y rattachait, celle du Travailleur. Ruinant la confortable intimité que celui-ci était parvenu à établir avec son mal. Alors que le travail n’a jamais été vécu autrement que sous la forme d’un supplice prolongé, d’officieux spécialistes cherchent encore à déterminer le seuil au-delà duquel il deviendrait intolérable.
11.
La politique classique s’est bâtie sur plusieurs axiomes présentés, par elle, comme indépassables. Le principe de gouvernementalité, c’est-à-dire l’organisation d’un besoin social en vertu duquel « il faut que les choses soient gouvernées » sans quoi elles retomberaient inévitablement dans le chaos. Et celui du travail qui, comme chantage, n’affirme rien de plus « qu’il faut bien vivre », et ce sans conditions et n’importe comment. En regard de cela, une étroite solidarité unit l’apparente diversité des conceptions politiques et des peurs paniques qui s’y rattachent. Et qui ne dérivent, en fin de compte, que d’une même anthropologie anémiée. D’un côté, projet cybernétique d’une gouvernance généralisée et de l’autre, idéal anarchiste d’un auto-gouvernement paradisiaque. Mythe du plein-emploi en faveur d’un développement durable et fable autogérée d’un travail libre, égalitairement partagé. De part et d’autre, une même disposition à la gestion managériale de ce qui fait la vie, un même acharnement à réprimer les plus beaux de nos instincts. Un même objectif de régulation désespéré. Mobilisation et Réquisition Totales désignent, d’un même mouvement, l’idéal éthique et pratique du militantisme le plus contestataire et du pouvoir qu’il feint de combattre.
12.
Retour de ce paradoxe : la contestation d’une réforme demeurant l’apanage des réformistes les plus avancés. Se mouvoir dans le calcul d’un avenir au point de perdre tout présent, toute présence. Schizophrénie, par exemple, de l’anarcho-syndicaliste codifiant, dès à présent, la postérité de la révolution, légiférant « l’après ». Or légiférer l’après, c’est déjà oublier le temps de maintenant. C’est perdre l’invincible nécessité d’un présent qui nous manque et pour lequel nous sommes en grève. L’épaisseur d’un temps qui ne saurait être réduit à la platitude d’une frise chronologique. La prévisibilité d’un avenir sera toujours en guerre avec la destination invisible d’un présent. La programmation d’un futur correspondra toujours à l’impossibilité d’un ici. « Dégager du temps libre » en faveur d’une meilleure gestion du temps de travail, voilà qui relève du plus douteux des utopismes. Opposer une certaine quantité de travail mort à l’ouvert d’un possible « œuvrer » vivant ne fait que jeter un plus le discrédit sur les tenants de cet optimisme. Il n’y a pas de travail qualitativement augmenté par une soustraction quantitative de sa durée. Il n’y a pas de durée de travail, en ce que le travail est la durée, le temps enduré.
13.
Le discours médiatique s’ingénie désormais à parler du climat de grève comme s’il s’agissait d’un tout nouveau pan de la science météorologique. ON s’inquiète des pénuries comme de l’imminence d’une canicule ; ON évoque les émeutes lycéennes à l’instar de subites tombées de neiges ; ON bavarde à propos de la grève comme ON le ferait de problématiques précipitations. Ainsi, chacun en a après la pluie, chacun peste sur ces prévisions. « Que retombent sur les bloqueurs les foudres populaires ! » Mais ça ne prend pas, bien sûr. Exhiber chaque soir, au fil d’inlassables bulletins d’information, tous les « mécontents », les « pris-en-otages », les « désespérés-de-la-pompe-à-essence », à la façon de touristes prisonniers des crues en Inde ou de mineurs chiliens perdus au fond d’une mine, s’avère annoncer une stratégie bien précaire de la part du pouvoir.
14.
Dans un monde où la circulation des flux s’est étendue à un niveau global, le parti du blocage, qui est aussi bien celui de l’insurrection, ne peut logiquement espérer vaincre s’il ne tisse, à un niveau tout aussi global, les solidarités nécessaires à sa permanence. Son champ d’action ne connaît pas de limites. Tout comme l’envergure, et la portée, de ses prétentions.
15.
Barcelone, 29 septembre 2010. Une journée de grève générale. Une journée en faveur de dix années d’un silence bruissant. Ce que l’on pensait avoir soigneusement enfermé dans le ghetto d’un milieu « antisystème » aux limites observables d’une périphérie sous contrôle, se réveille, se soulève à nouveau, s’embrase finalement. Dix années de démocratie socialiste n’auront finalement pas été à la hauteur de quarante années de fascisme. L’ordre mis à mal ce jour-là avait en effet les faux airs d’un phalangiste effarouché. Chacun dans la rue s’y retrouvait, à force de caillasses et de vitres brisées. Et les rires aussi, et les applaudissements, quand devait s’enfuir la police, à son tour presque poursuivie.
16.
À nouveau, le surgissement des « casseurs ». Plus personne, pourtant, ne saurait être dupe de cette figure de style. Toutes ces grands effets n’émeuvent plus grand monde. Seuls l’UNEF, peut-être, et l’Union Française des Anciens Combattants s’y montreront encore sensibles. De quoi s’agit-il aujourd’hui ? On pourrait parler d’un retour, notre retour : retour de la violence ouvrière, retour de la violence des enfants dans les rues, retour de la violence d’« anciens » qui sortent les pierres de leurs poches pour les offrir aux « jeunes » en guise d’hommage à ce qu’ils n’ont pas cessé de vouloir. Il y a ce mot d’un vieil homme à Lyon aux jeunes émeutiers qui s’y rencontraient : « Nous vous donnons les pierres que nous ne pouvons plus lancer. » Ce qui a été si bien désappris resurgit aujourd’hui avec la violence du refoulé. La magie liée à la figure du « casseur » ne semble plus très efficace à l’heure qu’il est, en ce que le banlieusard, l’étranger ou même l’anarchiste, bref l’en-dehors, ne saurait plus délimiter grand-chose. Car de quelle extériorité, de quelle marge saurait-il être sérieusement question, dans un monde qui ne connaît aucun dehors ? La question de la violence ne se pose plus, elle s’impose à tous.
17.
Aussi bien, les pratiques émeutières qui continuent d’émailler le mouvement mériteraient à être reconnues comme une autre forme, plus spécifique, plus surprenante, de blocage économique. Une paralysie complète des centres-villes par la récurrence incontrôlable de plusieurs journées d’affrontements et de pillages. Le GIPN en armes, face à des foules désarmées. Une leçon de tout cela est à tirer : la stratégie de blocage de l’économie ne peut se dissocier en aucune façon de la nécessité, impérieuse, d’anéantir et ou de mettre en déroute la totalité des forces de police.
18.
On ne se situe jamais seulement à l’intérieur d’un mouvement, mais par rapport à lui, face à lui, et peut-être même contre lui. Contre ce qui, en lui, tient de l’inconsistance. Le reflux de son vide et de son désespoir. Il s’agit de s’attaquer aux conditions matérielles et affectives qui nous attachent à ce monde. De rendre, non seulement impossible mais aussi indésirable, tout retour à la normale. Et pour cela, établir une cartographie de ce qui nous maintient dans cet état de servilité : flux, pouvoirs, affects, logistique et approvisionnement. D’acquérir, au fil d’amitiés conspiratives, les savoirs insurrectionnels par lesquels nous tiendrons ce monde en déroute. Nous avons appris les toutes premières lettres de l’abécédaire de la sédition. À savoir : paralyser des raffineries, des dépôts pétroliers, des autoroutes, des ports. Laisser les rues se remplir de déchets amoncelés, et en faire des barricades. Briser les vitrines qui nous renvoient à notre absence. Les questions qui se posent à nous pourraient être aussi bien : comment arrêter, définitivement, les centrales nucléaires ? Comment convertir la grève en désertion ? Comment se nourrir, se soigner, s’aimer, sans laisser ce monde en paix ?
« Le seul salut pour les vaincus est de n’attendre aucun salut »
France, le 27 octobre 2010.
Fichier PDF : greveinfinie
 Fichier PDF : laforetdelhistoire
Fichier PDF : laforetdelhistoire